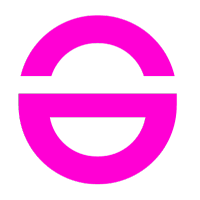I. Le contrôle fiscal à l'ère du FEC : origine et enjeux
1. La genèse du FEC et la digitalisation du contrôle fiscal
La digitalisation du contrôle fiscal est une ambition forte de l’Administration depuis plusieurs années. L’introduction du Fichier des Écritures Comptables constitue une étape majeure de cette stratégie. Elle rend possible la mise en place de contrôles exhaustifs à distance, reposant sur l’analyse des données contenues dans ce fichier, que les entreprises doivent désormais être en mesure de présenter rapidement.
Le contrôle fiscal avant l’introduction du FEC
Dès les années 1980, alors que l’utilisation des outils informatiques par les entreprises va croissante, l’administration fiscale s’adapte et se dote de moyens de contrôle adéquats. Ainsi en 1982, la notion de Contrôle Fiscal des Comptabilités Informatisées (CFCI) est définie : les vérificateurs sont autorisés à effectuer des traitements informatiques, et les premiers informaticiens rejoignent leurs rangs.
Mais, alors que la digitalisation de l’information comptable et fiscale se poursuit, la DGFiP fait face à un écueil : il n’existe pas de référentiel de présentation et d’archivage des données comptables commun aux entreprises. Se pose alors le problème de la capacité de l’Administration à exploiter des données aux formats très hétérogènes.
En 2005, l’OCDE recommande l’utilisation d’un fichier standardisé d’échange de données entre les entreprises et les administrations fiscales : le SAF-T. Le Fichier des Écritures Comptables (ou FEC), introduit en France en 2012 par la loi de finance rectificative pour 2012, en est une adaptation révisée pour se conformer aux particularités françaises et aux besoins spécifiques de la DGFiP.
Ce fichier reprend l’ensemble des écritures comptables d’un exercice dans un format normé défini à l’article A47 A-1 du Livre des Procédures Fiscales (LPF). Depuis 2014, les entreprises qui tiennent leur comptabilité au moyen de systèmes informatisés doivent obligatoirement remettre leur FEC aux vérificateurs lors d’un contrôle. À la suite de ce changement majeur, les modalités de contrôle évoluent.
Le contrôle fiscal « sur place », toujours en vie
La vérification de comptabilité est la procédure la plus connue, et souvent redoutée, du contrôle fiscal professionnel. Elle se déroule dans les locaux de l’entreprise, après l’envoi d’un avis de vérification.
Le vérificateur se déplace physiquement pour consulter les pièces justificatives, interroger les responsables et confronter la comptabilité aux déclarations fiscales. Il doit respecter les principes du débat oral et contradictoire, ainsi que les garanties prévues aux articles L.47 et suivants du Livre des procédures fiscales (LPF).
Depuis 2014, si la comptabilité est tenue de façon informatisée, l’entreprise doit obligatoirement remettre un FEC en ouverture des opérations. Ce fichier constitue la base de l’analyse du vérificateur. Il peut être exploré à l’aide d’outils d’extraction de données, de tris, de filtres ou de recherches par mots-clés.
La vérification peut durer plusieurs semaines et déboucher sur :
- Une absence de redressement ;
- Une proposition de rectification ;
- Dans certains cas, un rehaussement assorti de pénalités (erreur, manquement délibéré, fraude...)
L'examen de comptabilité, ou contrôle fiscal à distance
Créé par la loi de finances rectificative pour 2016 et inscrit à l’article L.13 G du LPF, l’examen de comptabilité est une procédure de contrôle à distance, destinée aux entreprises tenant une comptabilité informatisée.
Contrairement à la vérification de comptabilité, le vérificateur ne se déplace pas : il reste dans les locaux de l’administration, et adresse à l’entreprise un avis d’examen, dans lequel il lui demande de transmettre son FEC dans un délai de 15 jours.
Le FEC est ensuite analysé à l’aide de logiciels spécialisés. Le contrôleur dispose d’un délai de 6 mois pour formuler ses conclusions et notifier à l’entreprise une lettre d’absence de rectification, ou une proposition de rectification motivée.
Le dialogue entre l’entreprise et le vérificateur s’effectue principalement par courrier, téléphone ou email, mais un entretien peut être sollicité à tout moment pour éclaircir certains points.
Cette procédure est souvent considérée comme moins intrusive, moins coûteuse en temps et en organisation, mais tout aussi rigoureuse sur le fond.
Le contrôle sur pièces, invisible... mais très courant
Le contrôle sur pièces est une procédure quotidienne au sein de l’administration fiscale. Il consiste à analyser les déclarations fiscales (TVA, IS, CVAE, liasses, etc.) transmises par l’entreprise, sans prise de contact immédiate.
Ce contrôle s’effectue à distance, dans les bureaux de l’administration, à partir :
- Des éléments déclarés ;
- Des documents transmis spontanément ou sur demande ;
- Et de données internes ou croisées (ex : incohérence entre TVA et CA, anomalies dans les flux de comptes bancaires, etc.)
En cas d’incohérence ou d’anomalie présumée, l’administration peut envoyer une demande de renseignement ou de justification (article L.10 du LPF), ou adresser une proposition de rectification (article L.55 du LPF).
Le contrôle sur pièces peut également déboucher sur :
- Le rejet d'un crédit de TVA ;
- Une remise en cause de déductions fiscales ;
- Une évaluation d'office en cas de défaut de réponse.
Bien qu’invisible, ce contrôle est le plus fréquent : il constitue le premier niveau d’intervention du fisc et peut être le prélude à un contrôle plus poussé (examen ou vérification).
Un délai de 15 jours pour transmettre son FEC
Quelle que soit la procédure de contrôle dont elle fait l'objet, l'entreprise doit être en mesure de fournir son FEC au vérificateur dans un laps de temps très court. Dans le cas d'une vérification de comptabilité comme d'un examen à distance, le contribuable doit transmettre son FEC dans un délai de quinze jours après avoir été informé du contrôle.
C'est un délai difficile à tenir si l'entreprise ne s'est pas préalablement assurée de sa capacité à produire ce fichier, et de la conformité de ce dernier aux attentes de l'Administration. Cela signifie que pour parer à toute éventualité de contrôle, les entreprises ont intérêt à générer un FEC à la fin de chaque exercice, le vérifier et l'archiver, de manière systématique.
Amendes et sanctions
Le non-respect de l’obligation de transmission du FEC lors d’un contrôle fiscal donne lieu à des sanctions. Les entreprises s’exposent alors à une amende de 5 000€ (Art. 1729 D du Code général des impôts).
Cette amende s’applique lorsque :
- L’entreprise refuse de fournir son FEC ;
- Le FEC n’est pas transmis dans le délai de 15 jours ;
- Le FEC ne respecte pas les normes de format et de contenu définies par l’Administration.
Cette amende ne peut s’appliquer qu’une seule fois par contrôle, même s’il porte sur plusieurs exercices. Dans le cas où la vérification de comptabilité aboutit à un redressement, l’amende de 5 000€ peut être remplacée par une majoration de 10% des droits mis à la charge de l’entreprise.
2. Le rôle croissant de l'ECF dans la stratégie de la DGFiP
Qu'est-ce que l'Examen de Conformité Fiscale ?
L’Examen de Conformité Fiscale (ECF) a été créé par le décret n° 2021-25 du 13 janvier 2021. Ce nouveau dispositif s’inscrit dans la continuité de la loi ESSOC et vise à renforcer la relation de confiance entre l’Administration et les entreprises. Il permet à ces dernières de faire garantir la conformité de leur comptabilité, de manière volontaire, par un tiers de confiance.
Généralement réalisé par les experts-comptables, ou les Organismes de Gestion Agréés, l’ECF se compose de dix points clés. On retrouve parmi ces points la conformité du FEC et sa qualité comptable, le mode de conservation des documents, le respect des règles liées au régime d’imposition et de TVA, etc.
L’objectif : permettre aux entreprises de sécuriser leur position fiscale avant toute procédure de contrôle, dans une logique de conformité volontaire.
Une adoption en forte croissance
Le recours à l’ECF a nettement progressé ces dernières années. En 2024, ce sont 238 500 entreprises qui ont déclaré vouloir faire un ECF dans leur déclaration de résultats, contre 128 000 l’année précédente, soit une hausse de 86 %. Cette progression témoigne d’une prise de conscience croissante de l’intérêt préventif du dispositif.
Parmi ces entreprises, 64 % ont effectivement transmis un compte-rendu de mission (CRM) à l’administration fiscale. Ce CRM, élaboré par le tiers de confiance, atteste du respect ou non des 10 points audités. Dans près de 20 % des cas, des déclarations rectificatives ont été déposées à la suite de la réalisation d’un ECF.
D’après une enquête menée par la DGFiP fin 2024 auprès des contribuables ayant signalé un ECF, 88% se disent satisfaits du dispositif, et 87% déclarent envisager sereinement l’éventualité d’un contrôle fiscal.
Un outil de sécurisation à double effet
L’ECF n’est pas un simple audit formel : il ouvre des droits concrets pour l’entreprise qui s’y soumet. En transmettant le compte-rendu de mission faisant état des conclusions de conformité de chaque point, le professionnel fournit à l’Administration l’assurance raisonnable que la comptabilité est conforme.
En contrepartie, l’entreprise bénéficie des avantages suivants :
- Diminution drastique du risque de contrôle fiscal ;
- Sécurisation effective de l'aspect fiscal ;
- Suppression des pénalités et intérêts de retard en cas de redressement sur un point validé.
Autrement dit, l’ECF permet de transformer une obligation redoutée (le contrôle fiscal) en une opportunité de fiabiliser ses pratiques et de dialoguer de manière apaisée avec l’administration.
Une reconnaissance concrète par la DGFiP
La DGFiP soutient activement ce dispositif. Il a en effet été confirmé par ses représentants que la transmission d’un compte rendu de mission ECF est désormais prise en compte dans les algorithmes de ciblage des contrôles, ce qui n’était pas encore le cas les années précédentes. Dans un contexte où plus de la moitié des contrôles fiscaux sont aujourd’hui déclenchés par des outils d’IA ou de data mining, il est stratégique pour les entreprises d’envoyer un signal positif. L’ECF devient donc un véritable bouclier fiscal.
L’Examen de Conformité Fiscale marque une étape importante dans la modernisation du contrôle fiscal des professionnels en France. Il illustre la transition d’un système fondé sur la sanction vers un modèle basé sur la transparence, la confiance… et la donnée. Pour les entreprises comme pour leurs conseillers, il devient un levier stratégique de sécurisation fiscale à inscrire dans une démarche plus large de conformité proactive.